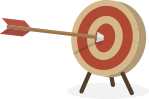Accueil > L'actualité immobilière à Toulouse > Que peut-on interdire à un locataire ?
Écrit par Sophie Castella publié le 08 août 2025
Que peut-on interdire à un locataire ?
Peut-on interdire à un locataire d’avoir un animal de compagnie ? De fumer dans l’appartement ? De sous-louer ou de repeindre les murs en noir ? Autant de questions que se posent régulièrement les propriétaires… parfois à tort.
Si le bailleur dispose de certains droits, la liberté du locataire dans l’usage de son logement est largement protégée par la loi du 6 juillet 1989. Et toute clause restrictive insérée dans le contrat de location ne fait pas forcément foi : de nombreuses interdictions sont considérées comme abusives, voire illégales.
Alors que peut-on vraiment interdire à son locataire ? Et surtout, quelles sont les limites à ne pas franchir pour rester dans les clous juridiquement ? En tant que spécialistes de l'immobilier neuf à Toulouse, nous vous proposons un tour d’horizon des droits (et des faux droits) du bailleur.
Ce que dit la loi sur l'usage du logement
Quand un locataire signe un bail, il ne signe pas pour vivre sous tutelle. La loi encadre strictement ce que le bailleur peut exiger, encadrer, ou interdire. Sur ce point, la position du législateur est sans équivoque : dès lors que le locataire entre dans les lieux, il bénéficie du droit de jouir paisiblement du logement, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public ni à la tranquillité du voisinage.
Ce principe, inscrit noir sur blanc dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, garantit au locataire ce que l’on appelle la jouissance paisible du bien. Concrètement, cela signifie que le propriétaire ne peut pas s’immiscer dans la vie privée du locataire : pas de visites impromptues, pas de droit de regard sur la décoration, et encore moins d’interdictions arbitraires.
Et pourtant, certains baux regorgent encore de clauses limitatives qui n’ont aucune valeur juridique. C’est là qu’interviennent les garde-fous posés par le Code de la consommation et les évolutions introduites par la loi ALUR de 2014. Ces textes réaffirment qu’un contrat de location ne peut ni restreindre les libertés individuelles, ni contenir de clauses abusives, telles que :
- Interdire de posséder un animal domestique,
- exiger un droit de visite hebdomadaire du logement,
- imposer le recours à un fournisseur d’énergie spécifique.
Toutes ces pratiques sont réputées non écrites, c’est-à-dire juridiquement nulles. Le locataire n’est donc pas tenu de les respecter, même s’il a signé le bail.
La location d’un bien ne donne pas au propriétaire un droit de contrôle, mais un droit de regard encadré par la loi. Et toute tentative de restreindre les libertés fondamentales du locataire peut se retourner contre le bailleur, en cas de litige.
Ce qu'un bailleur ne peut pas interdire

Lorsqu’un propriétaire loue son bien, il en conserve la propriété mais cède temporairement le droit d’usage exclusif au locataire. Et dans ce cadre, certaines interdictions fréquemment inscrites dans les baux ne tiennent pas juridiquement. Elles sont même considérées comme "non écrites", c’est-à-dire sans aucune valeur légale, même si le locataire a signé le contrat.
Avoir un animal de compagnie (dans certaines limites)
C’est sans doute l’interdiction la plus répandue... et la plus illégale. Un bailleur ne peut pas interdire à son locataire de posséder un animal de compagnie, comme un chat ou un petit chien. La jurisprudence est claire sur ce point : cette clause est réputée non écrite. Elle contrevient au droit fondamental de jouissance paisible du logement (article 10 de la loi du 9 juillet 1970).
Toutefois, certaines exceptions existent :
- Les chiens de catégorie 1, dits "dangereux", peuvent être interdits dans un immeuble collectif.
- En cas de nuisances avérées (bruits, dégradations, insalubrité), le bailleur peut intervenir.
- Le règlement de copropriété peut aussi limiter la présence d’animaux dans les parties communes, mais pas à l’intérieur du logement.
Fumer dans le logement
Fumer chez soi est un droit, même dans un logement loué. Le bailleur ne peut donc pas interdire à son locataire de fumer, y compris à l’intérieur du bien.
Toutefois, cette liberté n’est pas sans limites :
- Si le tabac provoque des dégradations importantes (murs jaunis, odeurs persistantes), le bailleur pourra exiger une remise en état à la sortie.
- En cas de troubles du voisinage (fumée dans les parties communes, odeurs envahissantes…), le locataire peut être mis en cause.
- Et bien sûr, en cas d’incendie, sa responsabilité pourrait être engagée.
Recevoir des invités ou héberger temporairement quelqu'un
Le droit d’héberger des proches est inhérent à la jouissance du logement. Le bailleur ne peut pas interdire à un locataire de recevoir des invités, ni même d’héberger un ami ou un membre de la famille pendant plusieurs semaines.
La seule limite réside dans le fait que cette cohabitation temporaire ne doit pas se transformer en sous-location déguisée :
- Le locataire ne doit pas percevoir de loyer de la part de la personne hébergée.
- En cas de doute, le bailleur est en droit de demander des éclaircissements, mais ne peut exiger une clause d’interdiction par défaut.
Modifier la décoration intérieure
Repeindre un mur, changer un luminaire ou poser des rideaux : autant de petits travaux que le locataire est en droit de réaliser, dès lors qu’ils n’altèrent pas la structure du logement.
En revanche :
- Les travaux lourds ou structurels (abattre une cloison, remplacer le sol, modifier la cuisine) nécessitent l’accord écrit du bailleur.
- À défaut, le bailleur est en droit d’exiger la remise en état à l’issue du bail, aux frais du locataire.
Ce qu'un bailleur peut interdire (ou encadrer)
Si le locataire jouit d’une large liberté dans l’usage de son logement, certaines pratiques peuvent être encadrées voire interdites par le bailleur, à condition de s’appuyer sur la loi ou sur des clauses claires et légitimes du contrat de location. Voici les cas où l’interdiction est juridiquement recevable.
La sous-location sans autorisation : un interdit par défaut
Contrairement à une idée reçue, un locataire ne peut pas sous-louer son logement librement. L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 est formel : la sous-location est interdite sans l’accord écrit du bailleur, et ce, qu’elle soit partielle ou totale.
Cet accord doit être :
- écrit et préalable à la sous-location,
- assorti de l’autorisation de percevoir un loyer.
Airbnb et les plateformes de location courte durée sont particulièrement concernées par cet encadrement. De nombreux bailleurs découvrent avec surprise leur logement loué à la nuitée, parfois à leur insu. Or, la justice est claire : en l’absence d’accord du propriétaire, ces pratiques sont illégales, et peuvent conduire à la résiliation du bail.
Les activités professionnelles dans un logement d’habitation : tolérées, sous conditions
Peut-on transformer son salon en bureau de téléconsultation ? Organiser des cours particuliers depuis sa chambre ? La réponse est oui, mais dans certaines limites.
L’usage d’un logement loué à titre d’habitation doit rester principalement résidentiel. Le bail et le règlement de copropriété peuvent interdire toute activité professionnelle avec réception de public ou salariés.
Sont généralement tolérées :
- les activités sans nuisance,
- sans réception de clientèle,
- sans transformation du local (pas de vitrine, pas d’enseigne…).
Exemple : un graphiste freelance, un écrivain ou un consultant peut travailler depuis chez lui sans contrevenir au bail. Mais un coiffeur ou un ostéopathe recevant des clients à domicile enfreindrait les règles s’il ne dispose pas d’un bail mixte ou d’une autorisation spécifique.
L’abandon du logement ou l’usage non conforme : des motifs valables de rupture
Un propriétaire est en droit d’exiger que son logement soit occupé selon sa destination prévue dans le bail. En cas d’usage dévoyé ou d’inoccupation prolongée sans justification, le bailleur peut agir.
Plusieurs situations posent problème :
- Un logement transformé en entrepôt ou lieu d’activité commerciale sans autorisation.
- Un bien laissé vide durant plusieurs mois, sans information ni paiement du loyer.
- Des nuisances répétées, plaintes du voisinage, dégradations.
Dans ces cas, le bailleur peut envoyer une mise en demeure, voire engager une procédure de résiliation judiciaire pour non-respect des obligations locatives. Mais attention : un simple départ en vacances prolongées ou une résidence alternée ne suffit pas à prouver l’abandon. La procédure reste encadrée et doit être strictement respectée.
Que faire en cas de non-respect du contrat par le locataire ?
Un loyer impayé, une sous-location non autorisée, des nuisances récurrentes ou des dégradations importantes : il arrive que la relation locative sorte du cadre légal prévu par le bail. Face à ces situations, le propriétaire n’est pas démuni. La loi prévoit une progressivité des recours, du dialogue amiable à la saisine du juge, à condition de respecter certaines étapes et de garder une trace écrite de chaque démarche.
Priorité au dialogue et à la mise en demeure
Avant d'enclencher une procédure plus lourde, la première étape reste la tentative de résolution à l’amiable. Il peut s’agir d’un simple échange verbal, d’un courrier ou d’un e-mail rappelant les obligations prévues au bail (loyer à jour, usage paisible, absence de sous-location, etc.).
Si cela ne suffit pas, il convient de formaliser la démarche par une mise en demeure écrite, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit :
- rappeler les faits reprochés au locataire (avec précision et preuves à l’appui),
- mentionner les clauses du bail ou articles de loi violés,
- et fixer un délai raisonnable pour régulariser la situation (généralement 15 à 30 jours).
Référence : la mise en demeure repose sur l’article 1217 du Code civil, qui ouvre droit à l’exécution forcée, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat en cas d’inexécution.
La voie de la conciliation : une solution intermédiaire
Si le dialogue direct échoue, il est possible de faire appel à un conciliateur de justice, un service gratuit proposé par l’État. Le conciliateur agit comme un médiateur neutre et tente de trouver un terrain d’entente entre les deux parties. Cette étape est souvent exigée avant d’entamer une procédure judiciaire, notamment pour les litiges de moins de 5 000 €.
La demande peut se faire :
- En ligne via justice.fr
- ou en contactant la maison de la justice et du droit la plus proche.
La conciliation aboutit parfois à un accord formalisé par écrit, ayant valeur contractuelle. Si aucun accord n’est trouvé, le bailleur peut alors saisir la justice.
Recours judicaire : résiliation du bail, action en justice, plainte
Si le non-respect du contrat persiste malgré les relances, le bailleur peut engager une procédure judiciaire. Selon la gravité du manquement, plusieurs voies sont possibles :
- Demander la résiliation judiciaire du bail devant le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance). Cela concerne notamment :
- les impayés de loyers répétés (articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989),
- les troubles manifestes du voisinage,
- l’utilisation non conforme du logement.
- Activer la clause résolutoire du bail, si elle est prévue au contrat. Dans ce cas, le bail est automatiquement rompu après un commandement de payer resté sans effet pendant 2 mois.
- Demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis (travaux de remise en état, frais de recouvrement, loyers impayés…).
- En cas de comportement frauduleux ou de dégradations volontaires, déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie. Cela peut entraîner des sanctions pénales, notamment pour violation de domicile, escroquerie ou dégradation volontaire.
Comment rédiger un bail conforme et équilibré ?
Dans le cas où le bailleur choisit de ne pas passer par une agence de gestion locative, la rédaction du bail lui incombe directement. Il est alors essentiel de s'appuyer sur un modèle de contrat conforme aux exigences légales. Le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 a instauré un bail type pour les locations vides ou meublées, accessible sur le site Service-Public.fr. Ce document encadre les mentions obligatoires et facultatives du contrat.
En cas de situation particulière ou de doute sur la validité d’une clause, il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel : juriste, notaire, avocat ou encore association de défense des propriétaires. Cela permet de sécuriser juridiquement la relation locative et d’éviter les contentieux liés à des clauses abusives ou mal formulées.
F.A.Q
Quelles interdictions sont légales dans un bail ?
- Sous-location sans accord écrit du bailleur (art. 8 loi du 6 juillet 1989)
- Activité professionnelle avec réception de public sans autorisation
- Usage du logement contraire à sa destination prévue au bail
Que faire en cas de non-respect du bail par le locataire ?
Commencer par un dialogue amiable, puis adresser une mise en demeure écrite. En cas d’échec : saisir un conciliateur de justice ou, en dernier recours, engager une procédure judiciaire (résiliation du bail, demande de dommages-intérêts, activation de la clause résolutoire).
Un bailleur peut-il limiter les visites ou interdire d’héberger quelqu’un ?
Non. Le locataire peut recevoir des invités et héberger temporairement des proches. En revanche, cela ne doit pas constituer une sous-location déguisée ou rémunérée.
Le propriétaire peut-il imposer un style de décoration ?
Non. Le locataire peut repeindre ou aménager la décoration intérieure tant que cela n’altère pas la structure du logement. Les travaux lourds ou structurels nécessitent un accord écrit.