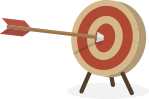Accueil > L'actualité immobilière à Toulouse > Tout comprendre à la garantie de parfait achèvement
Écrit par Sophie Castella publié le 08 juillet 2025
Tout comprendre à la garantie de parfait achèvement

Lorsqu'on réceptionne un logement neuf, tout semble terminé, mais les droits du propriétaire, eux, ne font que commencer. La garantie de parfait achèvement, souvent oubliée dans les méandres administratifs, joue pourtant un rôle prépondérant pour faire corriger les défauts apparents ou naissants. Véritable filet de sécurité, elle entre en jeu dès la remise des clés et s'étend sur une période bien définie. Voici ce qu’il faut savoir pour l’utiliser à bon escient.
Définition juridique et cadre légal
La garantie de parfait achèvement est une obligation légale imposée à l’entreprise en charge des travaux, et plus largement au constructeur lorsqu’il y en a un. Elle est définie dans le Code civil, à l’article 1792-6, qui précise :
« La garantie de parfait achèvement s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage [...] dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux. »
Article 1792-6, Code civil
En d’autres termes, cette garantie couvre l’ensemble des malfaçons et défauts constatés lors de la réception du chantier ou apparus dans les douze mois qui suivent, dès lors qu’ils sont signalés par écrit. Elle s’applique sans distinction : que les désordres soient graves ou bénins, esthétiques ou techniques, ils doivent être pris en charge par le "locateur d'ouvrage".
Une garantie obligatoire quel que soit le contrat
Cette garantie est obligatoire et automatique. Elle s’applique à tous les logements neufs, sans qu’il soit nécessaire de l’activer contractuellement. Aucun professionnel ne peut y déroger ou en restreindre l’application dans le contrat : toute clause en ce sens serait considérée comme nulle et non avenue, car elle contreviendrait à l’ordre public de la construction.
Elle incombe à l’entrepreneur ou au constructeur, et non au promoteur ou au vendeur (sauf si celui-ci est également le constructeur au sens juridique du terme). En cas de VEFA, le promoteur est toujours responsable vis-à-vis de l’acquéreur, mais il se retourne ensuite contre les entreprises concernées pour faire exécuter les réparations.
Un large champ d'application
Sont concernés tous les désordres affectant le logement, dès lors qu’ils sont signalés dans les formes :
- défauts de finitions (peintures mal exécutées, joints irréguliers, menuiseries défectueuses) ;
- dysfonctionnements techniques (portes qui coincent, volets qui ne ferment pas, fuites ponctuelles) ;
- défauts d’ajustement ou malfaçons apparentes.
Peu importe qu’il s’agisse d’un problème esthétique ou fonctionnel, dès lors qu’il s’agit d’un défaut d’exécution des travaux, la réparation est exigible. En revanche, ne relèvent pas de cette garantie :
- l’usure normale ou un défaut d’entretien ;
- les dommages causés par l’occupant ;
- ou les sinistres d’origine extérieure (intempéries, dégât des eaux, etc.).
Quels sont les désordres concernés ?
La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres signalés par l’acquéreur du logement neuf dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux. Sa portée est large et non limitée aux défauts graves. C’est ce qui la distingue notamment de la garantie décennale, centrée sur les atteintes à la solidité du bâtiment ou à son usage.
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, elle concerne :
« la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit dans le procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Article 1792-6, Code civil
Ce qui prime, c’est l’origine du désordre. S’il provient d’une erreur ou d’une négligence dans l’exécution des travaux, il doit être corrigé. Il n’est pas nécessaire de démontrer la gravité du défaut : le simple non-respect des règles de l’art ou des plans suffit.
Ce que la garantie couvre
Contrairement à une idée reçue, la garantie de parfait achèvement n’exige pas que les désordres soient structurels ou mettent en péril le logement. Elle concerne tout ce qui relève d’un défaut de conformité ou d’une mauvaise exécution, même mineure. Parmi les cas typiques :
- Finitions défectueuses : peintures mal appliquées, enduits cloqués, joints irréguliers, carreaux fissurés ou mal posés ;
- Menuiseries et fermetures : portes qui ferment mal, fenêtres voilées, volets roulants défectueux, poignées instables ;
- Équipements mal ajustés : interrupteurs non fixés, radiateurs qui vibrent, prises mal alignées, VMC bruyante ou mal équilibrée ;
- Problèmes fonctionnels mineurs mais récurrents : chasse d’eau qui fuit, mauvaise étanchéité de la douche, fissures de retrait sur plâtre frais.
La jurisprudence confirme régulièrement l’obligation de réparer ces désordres même s’ils ne compromettent pas l’usage du logement. La Cour de cassation a notamment jugé que même les défauts strictement esthétiques peuvent entrer dans le champ d’application de la garantie s’ils résultent d’une mauvaise exécution (Cass. civ. 3e, 7 décembre 2017, n° 16-26.309).
Ce que la garantie ne couvre pas
En revanche, certains problèmes ne relèvent pas de cette garantie, même s’ils surviennent dans l’année :
- Les dommages causés par le propriétaire ou un tiers après la remise des clés (ex. : rayure d’un parquet en emménageant) ;
- L’usure normale ou le vieillissement des matériaux (comme une micro-rayure sur une robinetterie) ;
- Les défauts liés à un entretien insuffisant (filtres de VMC non nettoyés, moisissures dues à une aération défaillante) ;
- Les sinistres d’origine extérieure : intempéries, infiltration non liée à une malfaçon, vandalisme.
Durée et déclenchement de la garantie
La garantie de parfait achèvement s’ouvre au moment où le logement neuf est officiellement livré à l’acquéreur, c’est-à-dire à la date de la réception des travaux. Elle reste valable pendant une durée stricte d’un an à compter de cette date.
C’est ce que précise clairement l’article 1792-6 du Code civil :
« Elle est due par l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception. »
Article 1792-6, Code civil
La période d’un an ne commence ni à la date d’emménagement, ni à celle de la signature de l’acte authentique chez le notaire (dans le cas d’une VEFA), mais bien à compter de la signature du procès-verbal de réception, qu’il comporte des réserves ou non.
Réception avec ou sans réserves : quelles différences ?
Si des désordres sont visibles au moment de la réception, ils doivent être consignés dans le procès-verbal de réception signé par l’acquéreur et le constructeur (ou le maître d’œuvre). Ces points sont alors considérés comme des réserves, que l’entreprise s’engage à lever dans un délai raisonnable.
Si les désordres apparaissent après la réception, ils doivent être notifiés par écrit dans l’année suivant cette réception. La loi n’impose pas un formalisme strict, mais dans les faits, il est fortement recommandé de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Comment faire jouer la garantie de parfait achèvement ?
La garantie de parfait achèvement n’est pas automatique dans sa mise en œuvre : elle existe de plein droit, mais elle doit être activée par le propriétaire, et selon des formes précises. L’entreprise ne viendra pas d’elle-même corriger les défauts si personne ne les signale. Il revient donc à l’acquéreur de prendre l’initiative, dans les délais et avec méthode.
Signaler les désordres dès la réception ou dans l’année suivante
Comme le prévoit l’article 1792-6 du Code civil, deux situations permettent d’activer la garantie :
- Le jour de la réception : les désordres visibles sont consignés dans le procès-verbal de réception. Ces réserves sont opposables à l’entreprise, qui doit y remédier.
- Après réception : tout désordre apparaissant dans l’année doit être notifié par écrit à l’entreprise concernée. Le moyen recommandé est la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qui apporte une preuve en cas de litige.
Respecter les délais et suivre l’exécution des réparations
Une fois la notification envoyée, l’entreprise a l’obligation d’intervenir dans un délai raisonnable. La loi ne fixe pas de durée précise. L’article 1792-6 du Code civil précise seulement que « les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur » ; à défaut d’entente, l’entrepreneur doit agir dans un « délai raisonnable », apprécié au cas par cas par les tribunaux.
En cas de silence ou d’inaction, une mise en demeure formelle peut être envoyée pour rappeler à l’entreprise ses obligations légales. Il est important de documenter chaque échange, et de relancer par écrit.
Que faire si l’entreprise refuse ou ne répond pas ?
Si l’entreprise conteste sa responsabilité, tarde excessivement ou ne donne pas suite, plusieurs recours sont possibles :
- Saisir le conciliateur de justice ou demander une médiation (souvent gratuite, utile pour débloquer un conflit).
- Faire intervenir un expert indépendant (par exemple via l’assurance dommages-ouvrage, si souscrite).
- En dernier recours, engager une procédure auprès du tribunal judiciaire pour forcer l’entreprise à exécuter les réparations.
Attention : si les réparations ne sont pas réalisées dans le délai d’un an, mais que les désordres ont été signalés dans les temps, la responsabilité de l’entreprise reste engagée. Ce qui compte, c’est la date de signalement, pas celle de la réparation ( Cour de cassation, 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-13.761).
Mise en demeure : la 1ère étape formelle
Si, après une première notification (par lettre recommandée avec AR), l’entreprise concernée ne donne pas suite ou se contente d’une réponse dilatoire, la première action à engager est une mise en demeure.
Prévue par l’ article 1344 du Code civil, la mise en demeure constitue une sommation d’agir dans un délai raisonnable, sous peine de recours. Elle doit :
- rappeler les désordres en cause,
- exiger leur réparation au titre de la garantie de parfait achèvement,
- fixer un délai clair (15 à 30 jours),
- être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d'échec : médiation ou action en justice
Médiation ou conciliation
- Avant d’aller au tribunal, il est souvent utile de passer par un conciliateur de justice, ou une médiation via la protection juridique de votre assurance habitation.
- C’est une procédure gratuite, rapide, et souvent efficace pour obtenir une solution amiable.
- En VEFA, vous pouvez également signaler le manquement au promoteur, qui a une obligation de résultat envers l’acquéreur (article L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).
Procédure judiciaire
- Si l’entreprise persiste à refuser d’intervenir, l’acquéreur peut saisir le tribunal judiciaire (ancien tribunal d’instance), compétent pour tous les litiges liés au droit de la construction.
- Il est recommandé de se faire accompagner d’un avocat et de fournir toutes les preuves (photos, courriers, mises en demeure, constats éventuels).
- Le tribunal peut ordonner l’exécution forcée des travaux, assortie de dommages et intérêts en cas de préjudice.
Et si les travaux doivent être faits en urgence ?
Dans certaines situations, les désordres nécessitent une intervention rapide (fuite, porte d’entrée non étanche, etc.). Si l’entreprise est absente ou refuse de réparer, il est possible de :
- faire appel à une autre entreprise pour une réparation provisoire, à condition de conserver tous les justificatifs,
- demander le remboursement par voie judiciaire par la suite.
Attention cependant : ne jamais engager de gros travaux de correction sans avoir, au préalable, tenté une résolution amiable ou judiciaire, sous peine de se voir opposer un refus de prise en charge.
Questions fréquentes sur la garantie de parfait achèvement
Quand démarre la garantie de parfait achèvement ?
Elle prend effet à la date de réception du logement, c’est-à-dire à la signature du procès-verbal de réception. C’est cette date, et non celle de l’acte notarié ou de l’emménagement, qui fait foi.
Que couvre-t-elle exactement ?
Elle couvre tous les désordres, qu’ils soient esthétiques, fonctionnels ou techniques, dès lors qu’ils sont dus à une mauvaise exécution des travaux. Cela inclut les défauts de finitions, les malfaçons apparentes ou les dysfonctionnements mineurs (portes qui ferment mal, peinture irrégulière, prises mal fixées…).
Comment activer la garantie ?
- Lors de la réception : en notant les réserves dans le procès-verbal.
- Après la réception : en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception à l’entreprise concernée, dans l’année qui suit.
Est-il obligatoire de faire un procès-verbal de réception pour que la garantie s’applique ?
Oui. La réception des travaux marque le point de départ de toutes les garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale). Sans procès-verbal, la date de réception peut être contestée. Si aucune réception formelle n’a eu lieu, il faut prouver une réception tacite (par exemple, par la prise de possession du logement).
Faut-il des preuves pour signaler un désordre ?
Ce n’est pas une obligation légale, mais c’est vivement recommandé. Joindre des photos datées, vidéos ou témoignages peut éviter tout litige sur la réalité ou l’origine du défaut. Cela facilitera aussi une action judiciaire si l’entreprise conteste.
Peut-on habiter le logement même si des réserves sont en cours ?
Oui. La remise des clés peut avoir lieu avec réserves, ce qui est fréquent. Cela n’empêche pas l’emménagement. En revanche, il est important de ne pas signer de levée de réserves prématurée, tant que les corrections n’ont pas été effectuées.